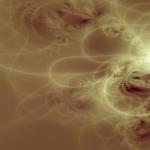Caractéristiques de la politique économique pendant la période de guerre. La politique du « communisme de guerre », son essence
Communisme de guerre- le nom de la politique intérieure de l'Etat soviétique, menée en 1918 - 1921. dans les conditions de la guerre civile. Ses traits caractéristiques étaient une centralisation extrême de la gestion économique, la nationalisation de la grande, moyenne et même petite industrie (partiellement), le monopole d'État sur de nombreux produits agricoles, l'appropriation des excédents, l'interdiction du commerce privé, la réduction des relations marchandise-argent, l'égalisation dans la répartition des biens. biens matériels, militarisation du travail. Cette politique était basée sur l'idéologie communiste, dans laquelle l'idéal d'une économie planifiée se traduisait par la transformation du pays en une usine unique, dont le « siège » gère directement tous les processus économiques. L'idée de construire immédiatement un socialisme sans marchandises en remplaçant le commerce par une distribution planifiée et organisée des produits à l'échelle nationale a été enregistrée comme politique du parti dans le II Programme du VIIIe Congrès du RCP (b) en mars 1919.
| Révolution de 1917 en Russie |
|---|
| Processus sociaux |
| Jusqu'en février 1917 : Conditions préalables à la révolution Février - octobre 1917 : |
| Institutions et organisations |
| Formations armées |
| Événements |
| Février - octobre 1917 : Après octobre 1917 : |
| Personnalités |
| Articles Liés |
Dans l'historiographie, il existe différentes opinions sur les raisons de la transition vers une telle politique - certains historiens pensaient qu'il s'agissait d'une tentative « d'introduire le communisme » en utilisant une méthode de commandement et les bolcheviks n'ont abandonné cette idée qu'après son échec, d'autres l'ont présentée comme une mesure temporaire, en réaction de la direction bolchevique aux réalités de la guerre civile. Les mêmes évaluations contradictoires ont été portées à cette politique par les dirigeants du Parti bolchevique eux-mêmes, qui ont dirigé le pays pendant la guerre civile. La décision de mettre fin au communisme de guerre et de passer à la NEP fut prise le 14 mars 1921 lors du Xe Congrès du RCP(b).
Éléments fondamentaux du « communisme de guerre »
La base du communisme de guerre était la nationalisation de tous les secteurs de l’économie. La nationalisation a commencé immédiatement après la Révolution socialiste d'octobre et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks - la nationalisation des « terres, ressources minérales, eaux et forêts » a été annoncée le jour de l'insurrection d'octobre à Petrograd, le 7 novembre 1917. L'ensemble des mesures socio-économiques mises en œuvre par les bolcheviks en novembre 1917 - mars 1918 s'appelait Attaque des Gardes rouges contre la capitale .
Liquidation des banques privées et confiscation des dépôts
L'une des premières actions des bolcheviks pendant la Révolution d'Octobre fut la prise armée de la Banque d'État. Les immeubles de banques privées ont également été saisis. Le 8 décembre 1917, le décret du Conseil des commissaires du peuple « sur la suppression de la Banque des terres nobles et de la Banque des terres paysannes » est adopté. Par le décret « sur la nationalisation des banques » du 14 (27) décembre 1917, le secteur bancaire fut déclaré monopole d'État. La nationalisation des banques en décembre 1917 fut renforcée par la confiscation des fonds publics. Tout l'or et l'argent en pièces et en lingots, ainsi que le papier-monnaie, s'ils dépassaient le montant de 5 000 roubles et avaient été acquis « sans rémunération », étaient confisqués. Pour les petits dépôts non confisqués, la norme pour recevoir de l'argent des comptes était fixée à 500 roubles par mois au maximum, de sorte que le solde non confisqué était rapidement englouti par l'inflation.
Nationalisation de l'industrie
Déjà en juin-juillet 1917, la « fuite des capitaux » commençait depuis la Russie. Les premiers à fuir furent les entrepreneurs étrangers à la recherche d’une main d’œuvre bon marché en Russie : après la Révolution de Février, l’establishment, la lutte pour des salaires plus élevés et les grèves légalisées prirent les entrepreneurs de leurs profits excédentaires. La situation constamment instable a poussé de nombreux industriels nationaux à fuir. Mais des réflexions sur la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises ont frappé le ministre du Commerce et de l'Industrie, complètement à gauche, A.I. Konovalov encore plus tôt, en mai, et pour d'autres raisons : des conflits constants entre industriels et ouvriers, qui ont provoqué des grèves d'une part et des lock-out. de l’autre, désorganisé l’économie déjà endommagée par la guerre.
Les bolcheviks furent confrontés aux mêmes problèmes après la révolution socialiste d’Octobre. Les premiers décrets du gouvernement soviétique ne prévoyaient aucun transfert des « usines aux ouvriers », comme en témoignent de manière éloquente les Règlements sur le contrôle ouvrier approuvés par le Comité exécutif central panrusse et le Conseil des commissaires du peuple le 14 novembre (27). , 1917, qui stipulait spécifiquement les droits des entrepreneurs. Mais le nouveau gouvernement était également confronté à des questions : que faire des entreprises abandonnées et comment prévenir les lock-out et autres formes de sabotage ?
Ce qui a commencé par l'adoption d'entreprises sans propriétaire, la nationalisation s'est ensuite transformée en une mesure de lutte contre la contre-révolution. Plus tard, lors du XIe Congrès du RCP(b), L. D. Trotsky a rappelé :
... A Petrograd, puis à Moscou, où s'est précipitée cette vague de nationalisation, des délégations des usines de l'Oural sont venues nous voir. Mon cœur me faisait mal : « Qu’allons-nous faire ? « Nous le prendrons, mais qu’allons-nous faire ? Mais les conversations avec ces délégations ont clairement montré que des mesures militaires sont absolument nécessaires. Après tout, le directeur d'une usine avec tous ses appareils, ses relations, son bureau et sa correspondance est une véritable cellule dans telle ou telle usine de l'Oural, de Saint-Pétersbourg ou de Moscou - une cellule de cette même contre-révolution - une cellule économique, fort, solide, qui est armé à la main se bat contre nous. Cette mesure était donc une mesure d’auto-préservation politiquement nécessaire. Nous ne pourrions passer à une explication plus correcte de ce que nous pouvons organiser et engager la lutte économique seulement après nous être assurés non pas une possibilité absolue, mais au moins relative de ce travail économique. D’un point de vue économique abstrait, nous pouvons dire que notre politique était mauvaise. Mais si on le place dans la situation mondiale et dans la situation de notre pays, alors du point de vue politique et militaire au sens large du terme, c'était absolument nécessaire.
La première à être nationalisée le 17 (30) novembre 1917 fut l'usine de la manufacture Likinsky de A. V. Smirnov (province de Vladimir). Au total, de novembre 1917 à mars 1918, selon le recensement industriel et professionnel de 1918, 836 entreprises industrielles furent nationalisées. Le 2 mai 1918, le Conseil des commissaires du peuple a adopté un décret sur la nationalisation de l'industrie sucrière et le 20 juin, de l'industrie pétrolière. À l’automne 1918, 9 542 entreprises étaient concentrées aux mains de l’État soviétique. Toute la grande propriété capitaliste des moyens de production a été nationalisée par la méthode de la confiscation gratuite. En avril 1919, presque toutes les grandes entreprises (de plus de 30 salariés) étaient nationalisées. Au début des années 1920, l’industrie moyenne était également largement nationalisée. Une gestion de production centralisée et stricte a été introduite. Le Conseil suprême de l'économie nationale a été créé pour gérer l'industrie nationalisée.
Monopole du commerce extérieur
Fin décembre 1917, le commerce extérieur fut placé sous le contrôle du Commissariat du Peuple au Commerce et à l'Industrie et, en avril 1918, il fut déclaré monopole d'État. La flotte marchande est nationalisée. Le décret sur la nationalisation de la flotte déclarait que les entreprises de transport maritime appartenant à des sociétés par actions, des sociétés en nom collectif, des maisons de commerce et des grands entrepreneurs individuels possédant des navires maritimes et fluviaux de tous types étaient la propriété nationale indivisible de la Russie soviétique.
Service de travail forcé
La conscription obligatoire du travail a été introduite, initialement pour les « classes non ouvrières ». Adopté le 10 décembre 1918, le Code du travail (LC) institue le service du travail pour tous les citoyens de la RSFSR. Les décrets adoptés par le Conseil des commissaires du peuple les 12 avril 1919 et 27 avril 1920 interdisaient les transferts non autorisés vers de nouveaux emplois et l'absentéisme et établissaient une discipline de travail stricte dans les entreprises. Le système de travail non rémunéré le week-end et les jours fériés sous forme de « subbotniks » et de « dimanches » s'est également généralisé.
Au début des années 1920, dans des conditions où la démobilisation des unités libérées de l'Armée rouge semblait prématurée, certaines armées furent temporairement transformées en armées de travail, qui conservèrent l'organisation et la discipline militaires, mais travaillèrent dans l'économie nationale. Envoyé dans l'Oural pour transformer la 3e armée en 1re armée du travail, L.D. Trotsky revient à Moscou avec une proposition de changement de politique économique : remplacer la saisie des excédents par une taxe alimentaire (avec cette mesure une nouvelle politique économique débutera dans un an ). Cependant, la proposition de Trotsky au Comité central n'a reçu que 4 voix contre 11, la majorité dirigée par Lénine n'était pas prête à un changement de politique et le IXe Congrès du RCP (b) a adopté une voie vers la « militarisation de l'économie ».
Dictature alimentaire
Les bolcheviks ont maintenu le monopole des céréales proposé par le gouvernement provisoire et le système d'appropriation des excédents introduit par le gouvernement tsariste. Le 9 mai 1918, un décret fut publié confirmant le monopole d'État sur le commerce des céréales (introduit par le gouvernement provisoire) et interdisant le commerce privé du pain. Le 13 mai 1918, le décret du Comité exécutif central panrusse et du Conseil des commissaires du peuple « sur l'octroi au commissaire du peuple à l'alimentation de pouvoirs d'urgence pour lutter contre la bourgeoisie rurale qui héberge et spécule sur les réserves de céréales » établit les dispositions fondamentales de la dictature alimentaire. L'objectif de la dictature alimentaire était de centraliser l'approvisionnement et la distribution de nourriture, de réprimer la résistance des koulaks et des bagages de combat. Le Commissariat du Peuple à l'Alimentation a reçu des pouvoirs illimités en matière d'achat de produits alimentaires. Sur la base du décret du 13 mai 1918, le Comité exécutif central panrusse a établi des normes de consommation par habitant pour les paysans - 12 livres de céréales, 1 livre de céréales, etc. - similaires aux normes introduites par le gouvernement provisoire en 1917. Toutes les céréales dépassant ces normes devaient être transférées à la disposition de l'État aux prix fixés par celui-ci. En fait, les paysans remettaient de la nourriture sans compensation (en 1919, seule la moitié des céréales réquisitionnées était compensée par de l'argent ou des biens industriels dépréciés, en 1920 - moins de 20 %).
Dans le cadre de l'instauration de la dictature alimentaire en mai-juin 1918, l'Armée de réquisition alimentaire du Commissariat du peuple à l'alimentation de la RSFSR (Prodarmiya) a été créée, composée de détachements alimentaires armés. Pour gérer l'Armée de l'Alimentation, le 20 mai 1918, le Bureau du Commissaire en chef et chef militaire de tous les détachements alimentaires a été créé sous l'égide du Commissariat du Peuple à l'Alimentation. Pour accomplir cette tâche, des détachements alimentaires armés furent créés, dotés de pouvoirs d'urgence.
V.I. Lénine a expliqué l'existence de l'appropriation des excédents et les raisons de son abandon :
L’impôt en nature est l’une des formes de transition d’une sorte de « communisme de guerre », contraint par l’extrême pauvreté, la ruine et la guerre, à un échange de produits socialiste correct. Et ce dernier, à son tour, est une des formes de transition du socialisme, caractérisé par la prédominance de la petite paysannerie dans la population, au communisme. Une sorte de « communisme de guerre » consistait dans le fait que nous prenions en fait aux paysans tout le surplus, et parfois même pas le surplus, mais une partie de la nourriture nécessaire au paysan, et que nous le prenions pour couvrir les frais de l'armée et l'entretien des ouvriers. Ils l’acceptaient principalement à crédit, en utilisant du papier-monnaie. Autrement, nous ne pourrions pas vaincre les propriétaires terriens et les capitalistes dans un petit pays paysan en ruine... Mais il n'en est pas moins nécessaire de connaître la véritable mesure de ce mérite. Le « communisme de guerre » a été imposé par la guerre et la ruine. Ce n’était pas et ne pouvait pas être une politique correspondant aux tâches économiques du prolétariat. C'était une mesure temporaire. La politique correcte du prolétariat, lorsqu'il exerce sa dictature dans un petit pays paysan, est l'échange de céréales contre des produits industriels dont le paysan a besoin. Seule une telle politique alimentaire répond aux tâches du prolétariat, seule elle est capable de renforcer les fondements du socialisme et de conduire à sa victoire complète.
L'impôt en nature est une transition vers celui-ci. Nous sommes encore tellement ruinés, tellement opprimés par l'oppression de la guerre (qui a eu lieu hier et qui pourrait éclater demain grâce à l'avidité et à la méchanceté des capitalistes) que nous ne pouvons pas fournir aux paysans des produits industriels pour toutes les céréales dont nous avons besoin. Sachant cela, nous introduisons un impôt en nature, c'est-à-dire le minimum nécessaire (pour l'armée et pour les ouvriers).
Le 27 juillet 1918, le Commissariat du Peuple à l'Alimentation adopta une résolution spéciale sur l'introduction d'une ration alimentaire de classe universelle, divisée en quatre catégories, prévoyant des mesures de comptabilisation des stocks et de distribution de nourriture. Au début, le rationnement de classe n'était valable qu'à Petrograd, à partir du 1er septembre 1918 - à Moscou - puis il fut étendu aux provinces.
Ceux fournis étaient répartis en 4 catégories (plus tard en 3) : 1) tous les travailleurs travaillant dans des conditions particulièrement difficiles ; les mères allaitantes jusqu'à la 1ère année de l'enfant et les nourrices ; les femmes enceintes à partir du 5ème mois 2) toutes celles qui travaillent dur, mais dans des conditions normales (non nocives) ; femmes - femmes au foyer avec une famille d'au moins 4 personnes et des enfants de 3 à 14 ans ; personnes handicapées de 1ère catégorie - personnes à charge 3) tous les travailleurs effectuant des travaux légers ; les femmes au foyer avec une famille de 3 personnes maximum ; les enfants de moins de 3 ans et les adolescents de 14 à 17 ans ; tous les étudiants de plus de 14 ans ; les chômeurs inscrits à la bourse du travail ; les retraités, les invalides de guerre et du travail et autres handicapés des 1ère et 2ème catégories comme personnes à charge 4) toutes les personnes de sexe masculin et féminin percevant des revenus du travail salarié d'autrui ; les personnes des professions libérales et leurs familles qui ne sont pas dans la fonction publique ; les personnes d'occupation non précisée et toute autre population non mentionnée ci-dessus.
Le volume distribué a été corrélé entre les groupes comme 4:3:2:1. En premier lieu, les produits des deux premières catégories ont été émis simultanément, dans la seconde, dans la troisième. Le 4ème a été publié lorsque la demande des 3 premiers a été satisfaite. Avec l'introduction des cartes de classe, toutes les autres furent abolies (le système de cartes était en vigueur à partir du milieu de 1915).
Dans la pratique, les mesures prises ont été beaucoup moins coordonnées et coordonnées que prévu sur papier. Trotsky, qui est revenu de l'Oural, a donné un exemple classique de centralisme excessif : dans une province de l'Oural, les gens mangeaient de l'avoine et dans une province voisine, ils nourrissaient les chevaux avec du blé, car les comités alimentaires provinciaux locaux n'avaient pas le droit d'échanger de l'avoine et du blé. avec l'un l'autre. La situation a été aggravée par les conditions de la guerre civile : de vastes zones de la Russie n'étaient pas sous le contrôle des bolcheviks et le manque de communications signifiait que même les régions formellement subordonnées au gouvernement soviétique devaient souvent agir de manière indépendante, en l'absence de contrôle centralisé depuis Moscou. La question demeure : le communisme de guerre était-il une politique économique au sens plein du terme, ou simplement un ensemble de mesures disparates prises pour gagner la guerre civile à tout prix.
Résultats du communisme de guerre
- Interdiction de l'entrepreneuriat privé.
- Élimination des relations marchandise-argent et transition vers un échange direct de marchandises réglementé par l'État. La mort de l'argent.
- Gestion paramilitaire des chemins de fer.
Le point culminant de la politique du « communisme de guerre » fut la fin de 1920 - début 1921, lorsque le Conseil des commissaires du peuple publia des décrets « Sur la libre fourniture de produits alimentaires à la population » (4 décembre 1920), « Sur la fourniture gratuite de biens de consommation à la population » (17 décembre), « Sur la suppression des taxes sur toutes sortes de carburants » (23 décembre).
Au lieu de la croissance sans précédent de la productivité du travail attendue par les architectes du communisme de guerre, il y a eu une forte baisse : en 1920, la productivité du travail est tombée, notamment en raison de la malnutrition de masse, à 18 % du niveau d'avant-guerre. Si avant la révolution le travailleur moyen consommait 3 820 calories par jour, ce chiffre était déjà tombé à 2 680 en 1919, ce qui n'était plus suffisant pour un travail physique pénible.
En 1921, la production industrielle avait triplé et le nombre d’ouvriers industriels avait diminué de moitié. Dans le même temps, les effectifs du Conseil suprême de l'économie nationale ont été multipliés par cent, passant de 318 personnes à 30 000 personnes ; Un exemple frappant est celui du Gasoline Trust, qui faisait partie de cet organisme, qui comptait désormais 50 personnes, malgré le fait que ce trust ne devait gérer qu'une seule usine de 150 travailleurs.
La situation est devenue particulièrement difficile à Petrograd, dont la population est passée de 2 millions 347 000 personnes pendant la guerre civile. à 799 mille, le nombre de travailleurs a diminué de cinq fois.
Le déclin de l'agriculture a été tout aussi brutal. En raison du désintérêt total des paysans pour l’augmentation des récoltes dans les conditions du « communisme de guerre », la production céréalière en 1920 a chuté de moitié par rapport à celle d’avant-guerre. Selon Richard Pipes,
Dans une telle situation, il suffisait que le temps se dégrade pour que la famine sévit dans le pays. Sous le régime communiste, il n’y avait pas d’excédent dans l’agriculture, donc s’il y avait une mauvaise récolte, il n’y aurait rien pour faire face à ses conséquences.
La voie adoptée par les bolcheviks vers le « dépérissement de l’argent » a conduit en pratique à une hyperinflation fantastique, qui a largement dépassé les « réalisations » des gouvernements tsaristes et provisoires.
La situation difficile de l'industrie et de l'agriculture a été aggravée par l'effondrement final des transports. La part des locomotives à vapeur dites « malades » est passée de 13 % avant la guerre à 61 % en 1921 ; le transport s'approchait du seuil au-delà duquel il n'y aurait plus de capacité que pour subvenir à ses propres besoins. De plus, le bois de chauffage était utilisé comme combustible pour les locomotives à vapeur, qui était collecté à contrecœur par les paysans dans le cadre de leur service de travail.
L’expérience d’organisation des armées ouvrières en 1920-1921 échoua également complètement. La Première Armée du Travail a démontré, selon les mots du président de son conseil (Président de l'Armée du Travail - 1) Trotsky L.D., une productivité du travail « monstrueuse » (monstrueusement faible). Seuls 10 à 25 % de son personnel étaient engagés dans une activité professionnelle en tant que telle, et 14 %, en raison de vêtements déchirés et du manque de chaussures, n'ont pas du tout quitté la caserne. Les désertions massives des armées ouvrières étaient généralisées et, au printemps 1921, elles étaient complètement incontrôlables.
Pour organiser le système d'appropriation alimentaire, les bolcheviks ont organisé un autre organisme considérablement élargi - le Commissariat du peuple à l'alimentation, dirigé par A.D. Tsyuryupa, mais malgré les efforts de l'État pour établir l'approvisionnement alimentaire, une famine massive de 1921-1922 a commencé, au cours de laquelle jusqu'à 5 des millions de personnes sont mortes. La politique du « communisme de guerre » (en particulier le système d’appropriation des surplus) a provoqué le mécontentement de larges couches de la population, en particulier de la paysannerie (soulèvements dans la région de Tambov, en Sibérie occidentale, à Kronstadt et dans d’autres). À la fin de 1920, une ceinture presque continue de soulèvements paysans (« déluge vert ») est apparue en Russie, aggravée par d'énormes masses de déserteurs et le début de la démobilisation massive de l'Armée rouge.
Évaluation du communisme de guerre
L'organe économique clé du communisme de guerre était le Conseil suprême de l'économie nationale, créé selon le projet de Yuri Larin, en tant qu'organe central de planification administrative de l'économie. Selon ses propres mémoires, Larine a conçu les principales directions (sièges) du Conseil économique suprême sur le modèle de la « Kriegsgesellschaften » allemande (allemand : Kriegsgesellschaften ; centres de régulation de l'industrie en temps de guerre).
Les bolcheviks ont déclaré que le « contrôle ouvrier » était l’alpha et l’oméga du nouvel ordre économique : « le prolétariat lui-même prend les choses en main ».
Le « contrôle ouvrier » a très vite révélé sa véritable nature. Ces paroles sonnaient toujours comme le début de la mort de l’entreprise. Toute discipline fut immédiatement détruite. Le pouvoir dans les usines et les usines a été transféré à des comités en évolution rapide, pratiquement responsables de rien devant personne. Des travailleurs honnêtes et bien informés ont été expulsés et même tués.
La productivité du travail a diminué de manière inversement proportionnelle à l'augmentation des salaires. Cette attitude s'est souvent exprimée par des chiffres vertigineux : les frais ont augmenté, mais la productivité a chuté de 500 à 800 pour cent. Les entreprises n'ont continué à exister que parce que soit l'État, propriétaire de l'imprimerie, a embauché des travailleurs pour l'entretenir, soit les travailleurs ont vendu et mangé les actifs fixes des entreprises. Selon l'enseignement marxiste, la révolution socialiste sera provoquée par le fait que les forces productives dépasseront les formes de production et, sous de nouvelles formes socialistes, auront la possibilité de se développer davantage et progressivement, etc., etc. L'expérience a révélé la fausseté de ces histoires. Sous les régimes « socialistes », la productivité du travail a connu un déclin extrême. Nos forces productives sous le « socialisme » ont régressé jusqu’à l’époque des usines de servage de Pierre.
L'autonomie démocratique a complètement détruit nos chemins de fer. Avec un revenu de 1,5 milliard de roubles, les chemins de fer ont dû payer environ 8 milliards rien que pour l'entretien des ouvriers et des employés.
Voulant s'emparer du pouvoir financier de la « société bourgeoise », les bolcheviks ont « nationalisé » toutes les banques lors d'un raid des Gardes rouges. En réalité, ils n’ont acquis que les quelques misérables millions qu’ils ont réussi à saisir dans les coffres-forts. Mais ils ont détruit le crédit et privé les entreprises industrielles de tous leurs fonds. Pour garantir que des centaines de milliers de travailleurs ne se retrouvent pas sans revenus, les bolcheviks ont dû ouvrir pour eux la caisse de la Banque d'État, qui était intensément réapprovisionnée par l'impression effrénée de papier-monnaie.
Une caractéristique de la littérature historique soviétique sur le communisme de guerre était une approche basée sur l’hypothèse du rôle exceptionnel et de « l’infaillibilité » de Vladimir Lénine. Étant donné que les « purges » des années trente « ont retiré de la scène politique » la plupart des dirigeants communistes de l’ère communiste de guerre, un tel « parti pris » pourrait facilement s’expliquer comme faisant partie de l’effort visant à « créer une épopée » de la révolution socialiste qui mettrait en valeur ses succès et « minimiserait » ses erreurs. Le « mythe du leader » était également répandu parmi les chercheurs occidentaux, qui pour la plupart « laissaient dans l'ombre » à la fois les autres dirigeants de la RSFSR de l'époque et « l'héritage » économique lui-même que les bolcheviks avaient hérité de l'Empire russe.
Dans la culture
voir également
Remarques
- Histoire des doctrines économiques / Ed. V. Avtonomova, O. Ananina, N. Makasheva : Manuel. allocation. - M. : INFRA-M, 2000. - P. 421.
- , Avec. 256.
- Histoire de l'économie mondiale : Manuel pour les universités / Ed. G.B. Polyak, A.N. Markova. - M. : UNITÉ, 2002. - 727 p.
- , Avec. 301.
- Orlov A.S., Georgieva N.G., Georgiev V.A. Dictionnaire historique. 2e éd. M., 2012, p. 253.
- Voir, par exemple : V. Tchernov. La grande révolution russe. M., 2007
- V. Tchernov. La grande révolution russe. p. 203-207
- Lohr, Éric. Nationalisation de l'Empire russe : la campagne contre les extraterrestres ennemis pendant la Première Guerre mondiale. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2003. - xi, 237 p. - ISBN9780674010413.
- Règlements du Comité exécutif central panrusse et du Conseil des commissaires du peuple sur le contrôle ouvrier.
- Onzième Congrès du RCP(b). M., 1961. P. 129
- Code des lois du travail de 1918 // Kiselev I. Ya. Droit du travail de Russie. Recherches historiques et juridiques. Manuel M., 2001
- L'Ordre Mémo pour la 3e Armée Rouge - 1re Armée Révolutionnaire du Travail, en particulier, disait : « 1. La 3e Armée a achevé sa mission de combat. Mais l’ennemi n’est pas encore complètement vaincu sur tous les fronts. Les impérialistes prédateurs menacent également la Sibérie depuis l’Extrême-Orient. Les troupes mercenaires de l’Entente menacent également la Russie soviétique depuis l’ouest. Il existe encore des gangs de gardes blancs à Arkhangelsk. Le Caucase n'est pas encore libéré. La 3ème armée révolutionnaire reste donc sous la baïonnette, maintenant son organisation, sa cohésion interne, sa combativité - au cas où la patrie socialiste l'appellerait à de nouvelles missions de combat. 2. Mais, empreinte du sens du devoir, la 3e armée révolutionnaire ne veut pas perdre de temps. Durant ces semaines et ces mois de répit qui lui étaient réservés, elle utiliserait ses forces et ses moyens pour le développement économique du pays. Tout en restant une force combattante menaçant les ennemis de la classe ouvrière, elle se transforme en même temps en une armée révolutionnaire du travail. 3. Le Conseil militaire révolutionnaire de la 3e Armée fait partie du Conseil de l'Armée du Travail. Là, outre les membres du conseil militaire révolutionnaire, se trouveront des représentants des principales institutions économiques de la République soviétique. Ils assureront le leadership nécessaire dans divers domaines de l’activité économique. Pour le texte complet de l'Ordre, voir : Mémo d'Ordre pour la 3e Armée Rouge - 1ère Armée Révolutionnaire du Travail
- En janvier 1920, lors du débat pré-congrès, furent publiées les « thèses du Comité central du Parti communiste russe sur la mobilisation du prolétariat industriel, la conscription du travail, la militarisation de l'économie et l'utilisation d'unités militaires pour les besoins économiques ». dont le paragraphe 28 disait : « En tant qu'une des formes de transition vers la mise en œuvre d'une conscription générale de travail et l'utilisation la plus large du travail socialisé, les unités militaires libérées des missions de combat, jusqu'aux grandes formations militaires, devraient être utilisées à des fins de travail. C'est là le sens de transformer la Troisième Armée en Première Armée du Travail et de transférer cette expérience à d'autres armées" (voir IXe Congrès du RCP (b). Rapport in extenso. Moscou, 1934. P. 529).
Tout au long de la guerre civile, les bolcheviks ont mené une politique socio-économique qui sera plus tard connue sous le nom de « communisme de guerre ». Elle est née, d'une part, des conditions d'urgence de l'époque (effondrement de l'économie en 1917, famine, notamment dans les centres industriels, lutte armée, etc.), et d'autre part, elle reflétait des idées sur la le dépérissement des relations marchandise-argent et du marché après la victoire de la révolution prolétarienne. Cette combinaison a conduit à la centralisation la plus stricte, à la croissance de l'appareil bureaucratique, à un système de gestion de commandement militaire et à une répartition égalitaire selon le principe de classe. Les principaux éléments de cette politique étaient les suivants :
- - affectation des excédents,
- - interdiction du commerce privé,
- - nationalisation de toute l'industrie et de sa gestion par l'intermédiaire de conseils centraux,
- - la conscription universelle du travail,
- - militarisation du travail,
- - les armées ouvrières,
- - système de cartes pour la distribution de produits et de marchandises,
- - coopération forcée de la population,
- - adhésion obligatoire à un syndicat,
- - des services sociaux gratuits (logement, transports, divertissements, journaux, éducation, etc.)
Essentiellement, le communisme de guerre a été généré avant 1918 par l’instauration d’une dictature bolchevique à parti unique, la création d’organismes répressifs et terroristes et la pression sur les campagnes et le capital. Le véritable moteur de sa mise en œuvre était la baisse de la production et la réticence des paysans, pour la plupart des paysans moyens, qui ont finalement reçu des terres, la possibilité de développer leurs exploitations et de vendre des céréales à des prix fixes. En conséquence, un ensemble de mesures ont été mises en pratique, censées conduire à la défaite des forces de la contre-révolution, stimuler l'économie et créer des conditions favorables à la transition vers le socialisme. Ces mesures ont touché non seulement la politique et l’économie, mais en réalité toutes les sphères de la société.
Dans le domaine économique : nationalisation généralisée de l'économie (c'est-à-dire enregistrement législatif du transfert d'entreprises et d'industries vers la propriété de l'État, ce qui ne signifie toutefois pas qu'elles deviennent la propriété de la société entière). Par décret du Conseil des commissaires du peuple du 28 juin 1918, les industries minières, métallurgiques, textiles et autres sont nationalisées. À la fin de 1918, sur 9 000 entreprises de la Russie européenne, 3 500 étaient nationalisées, à l'été 1919 - 4 000, et un an plus tard, environ 7 000 entreprises employaient 2 millions de personnes (soit environ 70 pour cent). des employés). La nationalisation de l'industrie a donné naissance à un système de 50 administrations centrales qui géraient les activités des entreprises qui distribuaient les matières premières et les produits qui en résultaient. En 1920, l’État était pratiquement propriétaire indivis des moyens de production industriels.
Le prochain aspect qui détermine l’essence de la politique économique du « communisme de guerre » est l’appropriation des surplus. En termes simples, la « prodrazvyorstka » est l’imposition forcée de l’obligation de remettre la production « excédentaire » aux producteurs de denrées alimentaires. Bien entendu, cela incombait principalement au village, principal producteur de produits alimentaires. Dans la pratique, cela a conduit à la confiscation forcée de la quantité de céréales requise par les paysans, et les formes d'appropriation des excédents ont laissé beaucoup à désirer : les autorités ont suivi la politique habituelle de péréquation et, au lieu de faire peser le poids des impôts sur les paysans riches, ils ont volé les paysans moyens, qui constituaient la majeure partie des producteurs de denrées alimentaires. Cela ne pouvait que provoquer un mécontentement général, des émeutes ont éclaté dans de nombreuses régions et des embuscades ont été tendues contre l'armée alimentaire. L'unité de la paysannerie se manifestait contre la ville comme contre le monde extérieur.
La situation fut aggravée par les soi-disant comités des pauvres, créés le 11 juin 1918, destinés à devenir un « second pouvoir » et à confisquer les produits excédentaires (on supposait qu'une partie des produits confisqués irait aux membres de ces comités). ) ; leurs actions devaient être soutenues par des éléments de « l’armée de la nourriture ». La création des comités Pobedy témoignait de l’ignorance totale des bolcheviks de la psychologie paysanne, dans laquelle le principe communal jouait le rôle principal.
En conséquence, la campagne d'appropriation des excédents de l'été 1918 échoua : au lieu de 144 millions de pouds de céréales, seuls 13 furent collectés, ce qui n'empêcha cependant pas les autorités de poursuivre la politique d'appropriation des excédents pendant encore plusieurs années.
Le 1er janvier 1919, la recherche chaotique des excédents fut remplacée par un système centralisé et planifié d’appropriation des excédents. Le 11 janvier 1919, le décret « Sur l'attribution des céréales et du fourrage » est promulgué. Selon ce décret, l’État communiquait au préalable le chiffre exact de ses besoins alimentaires. C'est-à-dire que chaque région, département, volost devait remettre à l'État une quantité prédéterminée de céréales et d'autres produits, en fonction de la récolte attendue (déterminée de manière très approximative, selon les données des années d'avant-guerre). L'exécution du plan était obligatoire. Chaque communauté paysanne était responsable de son propre approvisionnement. Ce n'est qu'après que la communauté s'est pleinement conformée à toutes les exigences de l'État pour la livraison des produits agricoles que ce travail a été téléchargé sur Internet, les paysans ont reçu des reçus pour l'achat de biens industriels, mais en quantités bien inférieures à celles requises (10-15 pour cent), et l'assortiment se limitait uniquement aux biens de première nécessité : tissus, allumettes, kérosène, sel, sucre et parfois des outils (en principe, les paysans acceptaient d'échanger de la nourriture contre des biens industriels, mais l'État n'en avait pas en quantité suffisante ). Les paysans ont réagi à l’excédent d’appropriation et à la pénurie de biens en réduisant les superficies cultivées (jusqu’à 60 pour cent selon les régions) et en revenant à une agriculture de subsistance. Par la suite, par exemple, en 1919, sur les 260 millions de pouds de céréales prévus, 100 seulement furent récoltés, et encore avec beaucoup de difficulté. Et en 1920, le plan n'a été réalisé qu'à 3 à 4 %.
Puis, après avoir retourné les paysans contre eux-mêmes, le système d'appropriation des surplus ne satisfaisait pas non plus les citadins : il était impossible de vivre de la ration journalière prescrite, les intellectuels et les « anciens » étaient approvisionnés en dernier, et souvent ne recevaient rien du tout. . En plus de l'injustice du système d'approvisionnement alimentaire, il était également très déroutant : à Petrograd, il existait au moins 33 types de cartes alimentaires avec une date d'expiration ne dépassant pas un mois.
Parallèlement à l'appropriation des excédents, le gouvernement soviétique introduit toute une série de droits : le bois, les droits sous-marins et hippomobiles, ainsi que le travail.
L’énorme pénurie émergente de biens, y compris de biens essentiels, crée un terrain fertile pour la formation et le développement d’un « marché noir » en Russie. Le gouvernement a tenté en vain de lutter contre les collecteurs de fonds. Les forces de l'ordre ont reçu l'ordre d'arrêter toute personne possédant un sac suspect. En réponse à cela, les ouvriers de nombreuses usines de Petrograd se sont mis en grève. Ils ont exigé l'autorisation de transporter librement des sacs pesant jusqu'à un kilo et demi, ce qui indiquait que les paysans n'étaient pas les seuls à vendre secrètement leur « surplus ». Les gens étaient occupés à chercher de la nourriture, les ouvriers abandonnaient les usines et, fuyant la faim, retournaient dans les villages. La nécessité pour l'État de prendre en compte et de sécuriser la main-d'œuvre en un seul lieu oblige le gouvernement à introduire des « cahiers de travail », ces ouvrages ont été téléchargés sur Internet, et le Code du travail étend le service du travail à l'ensemble de la population âgée de 16 à 50 ans. . Dans le même temps, l'État a le droit de procéder à des mobilisations ouvrières pour tout travail autre que le travail principal.
Une manière fondamentalement nouvelle de recruter des travailleurs fut la décision de transformer l’Armée rouge en une « armée du travail » et de militariser les chemins de fer. La militarisation du travail transforme les travailleurs en combattants du front du travail qui peuvent être transférés n'importe où, qui peuvent être commandés et qui sont passibles de poursuites pénales pour violation de la discipline du travail.
Trotsky, par exemple, pensait que les ouvriers et les paysans devaient être mis à la place des soldats mobilisés. Croire que « celui qui ne travaille pas ne mange pas, et puisque tout le monde doit manger, alors tout le monde doit travailler ». En 1920, en Ukraine, région sous contrôle direct de Trotsky, les chemins de fer étaient militarisés et toute grève était considérée comme une trahison. Le 15 janvier 1920, la première Armée révolutionnaire du travail est formée, issue de la 3e Armée de l'Oural, et en avril, la Deuxième Armée révolutionnaire du travail est créée à Kazan.
Les résultats se sont avérés déprimants : les soldats et les paysans étaient des ouvriers non qualifiés, ils étaient pressés de rentrer chez eux et n'étaient pas du tout désireux de travailler.
Un autre aspect de la politique, qui est probablement le principal et qui a le droit d'occuper la première place, est l'instauration d'une dictature politique, une dictature à parti unique du Parti bolchevique.
Les opposants politiques, les opposants et les concurrents des bolcheviks ont été soumis à la pression d'une violence généralisée. Les activités de publication sont réduites, les journaux non bolcheviques sont interdits, les dirigeants des partis d'opposition sont arrêtés, puis mis hors la loi. Dans le cadre de la dictature, les institutions indépendantes de la société sont contrôlées et progressivement détruites, la terreur de la Tchéka s'intensifie et les Soviétiques « rebelles » de Luga et de Cronstadt sont dissous par la force.
Créée en 1917, la Tchéka a été conçue à l'origine comme un organisme d'enquête, mais les Tchékas locales se sont rapidement arrogées le droit, après un court procès, de tirer sur les personnes arrêtées. La terreur était généralisée. Rien que pour l'attentat contre Lénine, la Tchéka de Petrograd a abattu, selon les rapports officiels, 500 otages. C'est ce qu'on appelle la « Terreur rouge ».
Le « pouvoir d'en bas », c'est-à-dire le « pouvoir des Soviétiques », qui s'était renforcé depuis février 1917 à travers diverses institutions décentralisées créées comme une opposition potentielle au pouvoir, commença à se transformer en « pouvoir d'en haut », s'arrogeant tout le pouvoir. pouvoirs possibles, en utilisant des mesures bureaucratiques et en recourant à la violence.
Nous devons en dire davantage sur la bureaucratie. A la veille de 1917, il y avait environ 500 000 fonctionnaires en Russie et pendant les années de guerre civile, l'appareil bureaucratique a doublé. Initialement, les bolcheviks espéraient résoudre ce problème en détruisant l'ancien appareil administratif, mais il s'est avéré qu'il était impossible de se passer du personnel précédent, des « spécialistes », et du nouveau système économique, avec son contrôle sur tous les aspects de la vie. a favorisé la formation d’une toute nouvelle bureaucratie de type soviétique. La bureaucratie est ainsi devenue partie intégrante du nouveau système.
Un autre aspect important de la politique du « communisme de guerre » est la destruction du marché et des relations marchandise-argent. Le marché, principal moteur du développement du pays, est constitué de liens économiques entre les producteurs individuels, les industries et les différentes régions du pays. La guerre a rompu et déchiré tous les liens. Parallèlement à la baisse irrévocable du taux de change du rouble (en 1919, il était égal à 1 kopeck du rouble d'avant-guerre), il y eut un déclin du rôle de la monnaie en général, inévitablement entraîné par la guerre. En outre, la nationalisation de l'économie, la domination indivise du mode de production étatique, la centralisation excessive des organismes économiques, l'approche générale des bolcheviks d'une nouvelle société comme étant sans argent, ont finalement conduit à l'abolition du marché et du système marchand. relations monétaires.
Le 22 juillet 1918, le décret du Conseil des commissaires du peuple « Sur la spéculation » fut adopté, interdisant tout commerce non étatique. À l'automne, dans la moitié des provinces qui n'ont pas été capturées par les Blancs, le commerce de gros privé a été liquidé et dans un tiers, le commerce de détail a été liquidé. Pour approvisionner la population en nourriture et en biens personnels, le Conseil des commissaires du peuple a décrété la création d'un réseau d'approvisionnement de l'État. Une telle politique nécessitait la création d'organismes économiques super-centralisés spéciaux chargés de la comptabilité et de la distribution de tous les produits disponibles. Les conseils centraux (ou centres) créés sous l'égide du Conseil économique suprême contrôlaient les activités de certaines industries, étaient chargés de leur financement, de leur approvisionnement matériel et technique et de la distribution des produits manufacturés.
Parallèlement, s'opère la nationalisation des banques ; à leur place, est créée en 1918 la Banque populaire, qui est en fait un département du Commissariat aux Finances (par décret du 31 janvier 1920, elle fusionne avec un autre département de la même institution et transformé en Département des Règlements Budgétaires). Au début de 1919, le commerce privé est entièrement nationalisé, à l'exception du marché (sur les étals).
Ainsi, le secteur public représente déjà près de 100 pour cent de l’économie, donc il n’y avait besoin ni de marché ni d’argent. Mais si les liens économiques naturels sont absents ou ignorés, alors leur place est prise par des liens administratifs établis par l'État, organisés par ses décrets, arrêtés, mis en œuvre par les agents de l'État - fonctionnaires, commissaires. Ainsi, pour que les gens croient à la justification des changements qui s'opèrent dans la société, l'État a utilisé une autre méthode d'influence sur les esprits, qui fait également partie intégrante de la politique du « communisme de guerre », à savoir : idéologique, théorique et culturel. L'État a inculqué : la foi en un avenir radieux, la propagande sur l'inévitabilité de la révolution mondiale, la nécessité d'accepter la direction des bolcheviks, l'instauration d'une éthique qui justifie tout acte commis au nom de la révolution, la nécessité de créer un une nouvelle culture prolétarienne a été promue.
Qu’a finalement apporté le « communisme de guerre » au pays ? Les conditions sociales et économiques ont été créées pour la victoire sur les interventionnistes et les gardes blancs. Il était possible de mobiliser les forces insignifiantes dont disposaient les bolcheviks et de subordonner l'économie à un seul objectif : fournir à l'Armée rouge les armes, les uniformes et la nourriture nécessaires. Les bolcheviks ne disposaient que d'un tiers des entreprises militaires russes, contrôlaient des zones qui ne produisaient pas plus de 10 % du charbon, du fer et de l'acier et ne disposaient presque pas de pétrole. Malgré cela, pendant la guerre, l'armée a reçu 4 000 canons, 8 millions d'obus et 2,5 millions de fusils. En 1919-1920, elle reçut 6 millions de pardessus et 10 millions de paires de chaussures.
Les méthodes bolcheviques de résolution des problèmes ont conduit à l'établissement d'une dictature bureaucratique du parti et en même temps à un mécontentement spontané des masses : la paysannerie a dégradé, sans ressentir au moins aucune importance, la valeur de son travail ; le nombre de chômeurs a augmenté ; les prix doublaient chaque mois.
En outre, le résultat du « communisme de guerre » a été un déclin de la production sans précédent. En 1921, le volume de la production industrielle ne représentait que 12 % du niveau d'avant-guerre, le volume des produits vendus diminuait de 92 % et le trésor public était reconstitué à 80 % grâce à l'affectation des excédents. Au printemps et en été, une terrible famine a éclaté dans la région de la Volga. Après la confiscation, il n'y avait plus de céréales. Le « communisme de guerre » n’a pas non plus réussi à fournir de la nourriture à la population urbaine : la mortalité parmi les travailleurs a augmenté. Avec le départ des ouvriers vers les villages, la base sociale des bolcheviks se rétrécit. Seule la moitié du pain passait par la distribution étatique, le reste par le marché noir, à des prix spéculatifs. La dépendance sociale s'est accrue. Un appareil bureaucratique s'est développé, soucieux du maintien de la situation existante, car cela signifiait également la présence de privilèges.
À l’hiver 1921, le mécontentement général à l’égard du « communisme de guerre » avait atteint ses limites. La situation économique désastreuse, l'effondrement des espoirs d'une révolution mondiale et la nécessité de toute action immédiate pour améliorer la situation du pays et renforcer le pouvoir des bolcheviks ont contraint les cercles dirigeants à admettre leur défaite et à abandonner le communisme de guerre en faveur du Nouveau Politique économique.
Les activités dans le cadre de la politique militaire sont menées de manière générale dès 1919 et se matérialisent sous la forme de trois orientations principales. Les principales entreprises industrielles sont devenues les principales. Le deuxième groupe de mesures comprenait la mise en place d'un approvisionnement centralisé pour la population russe et le remplacement du commerce par une distribution forcée par l'appropriation des excédents. La conscription universelle du travail a également été introduite.
L'organisme qui gouverna le pays pendant la période de cette politique était le Conseil de défense ouvrière et paysanne, créé en novembre 1918. La transition vers le communisme de guerre a été provoquée par le déclenchement de la guerre civile et par les puissances capitalistes, qui ont conduit à la dévastation. Le système lui-même n’a pas pris forme d’un seul coup, mais progressivement, à mesure que les tâches économiques prioritaires étaient résolues.
Les dirigeants du pays se sont fixé pour objectif de mobiliser le plus rapidement possible toutes les ressources du pays pour les besoins de défense. C’était précisément l’essence profonde du communisme de guerre. Depuis que les instruments économiques traditionnels, tels que l’argent, le marché et l’intérêt matériel dans les résultats du travail, ont pratiquement cessé de fonctionner, ils ont été remplacés par des mesures administratives, dont la plupart étaient de nature clairement coercitive.
Caractéristiques de la politique du communisme de guerre
La politique du communisme de guerre était particulièrement visible dans l'agriculture. L'État a établi son monopole sur le pain. Des organismes spéciaux ont été créés, dotés de pouvoirs d'urgence pour acheter de la nourriture. Les soi-disant détachements alimentaires ont pris des mesures pour identifier et confisquer de force les surplus de céréales de la population rurale. Les produits étaient confisqués sans paiement ou en échange de biens industriels, les billets de banque ne valant presque rien.
Pendant les années du communisme de guerre, le commerce des produits alimentaires, considéré comme la base de l'économie bourgeoise, était interdit. Toute la nourriture devait être remise aux agences gouvernementales. Le commerce a été remplacé par une distribution organisée de produits à l'échelle nationale, basée sur un système de cartes et à travers des sociétés de consommation.
Dans le domaine de la production industrielle, le communisme de guerre impliquait la nationalisation des entreprises dont la gestion reposait sur les principes de la centralisation. Les méthodes non économiques de conduite des activités économiques étaient largement utilisées. Le manque d'expérience des dirigeants nommés au début entraînait souvent une baisse de l'efficacité de la production et avait un impact négatif sur le développement de l'industrie.
Cette politique, menée jusqu'en 1921, peut être qualifiée de dictature militaire avec recours à la coercition dans l'économie. Ces mesures ont été forcées. Le jeune État, étouffé par la guerre civile et l’intervention, n’avait ni le temps ni les ressources supplémentaires pour développer systématiquement et lentement des activités économiques par d’autres méthodes.
Le communisme de guerre est une politique mise en œuvre par le gouvernement soviétique pendant la guerre civile. Ensuite, la politique du communisme de guerre impliquait la nationalisation des grandes et moyennes industries, l'appropriation des surplus, la nationalisation des banques, la conscription de la main-d'œuvre, le refus d'utiliser l'argent pour le commerce extérieur. En outre, la politique du communisme de guerre se caractérise par la gratuité des transports, la suppression des frais pour les services médicaux, la gratuité de l'éducation et la gratuité de l'éducation. L'une des principales caractéristiques par lesquelles nous pouvons caractériser cette politique est la centralisation la plus sévère de l'économie.
Lorsqu'ils évoquent les raisons pour lesquelles les bolcheviks ont mené une telle politique, on dit souvent que la politique du communisme de guerre correspondait à l'idéologie marxiste des bolcheviks, à leurs idées sur l'avènement du communisme, l'égalité universelle, etc. Cependant, ce point de vue est incorrect. Le fait est que les bolcheviks eux-mêmes ont souligné dans leurs discours que la politique du communisme de guerre était un phénomène temporaire et qu'elle était provoquée par les conditions les plus graves de la guerre civile. Le bolchevik Bogdanov, avant même l’établissement du pouvoir communiste, écrivait qu’un tel système découlait des conditions de guerre. Il fut le premier à proposer de qualifier un tel système de communisme de guerre. Un certain nombre d'historiens affirment également que le communisme de guerre est un système provoqué par des facteurs objectifs, et des systèmes similaires ont été trouvés dans d'autres pays et sous d'autres gouvernements dans des conditions extrêmes similaires. Par exemple, l’appropriation des surplus est un système selon lequel le paysan donnait de la nourriture à des prix fixés par l’État. Il existe un mythe assez répandu selon lequel les bolcheviks auraient inventé l’appropriation des excédents. En fait, l’appropriation des excédents a été introduite par le gouvernement tsariste pendant la Première Guerre mondiale. Il s’avère que bon nombre des mesures du communisme de guerre ne sont pas des inventions spécifiques de la pensée socialiste, mais des méthodes universelles pour la survie de l’économie d’État dans des conditions extrêmes.
Cependant, cette politique impliquait également des phénomènes qui pouvaient être spécifiquement attribués aux innovations socialistes. Il s'agit par exemple de la gratuité des transports, de la suppression des frais pour les services médicaux, de la gratuité de l'enseignement et de l'absence de frais pour les services publics. Il sera difficile de trouver des exemples où l’État se trouve dans les conditions les plus graves et procède en même temps à de telles transformations. Bien que, peut-être, ces événements correspondaient non seulement à l'idéologie marxiste, mais contribuaient également à la croissance de la popularité des bolcheviks.
Une telle politique ne pouvait pas être maintenue pendant longtemps et elle n’était pas nécessaire en temps de paix. Au fil du temps, une crise s'est ensuivie dans la politique du communisme de guerre, comme en témoignent les soulèvements paysans constants. À cette époque, les paysans croyaient que toutes les difficultés étaient temporaires et qu’après la victoire des communistes, la vie deviendrait plus facile. À la fin de la guerre, les paysans ne voyaient plus l’intérêt d’une centralisation excessive. Si le début du communisme est associé à 1918, alors la fin du communisme de guerre est considérée comme 1921, lorsque le système d'appropriation des excédents a été aboli et qu'un impôt en nature a été introduit à sa place.
Le communisme de guerre est un phénomène qui a été provoqué par des raisons objectives, qui était une mesure forcée et qui a été annulé lorsque sa nécessité n'était plus nécessaire. L'effondrement d'une telle politique a été facilité par les soulèvements paysans répétés, ainsi que par les événements survenus chez les marins en 1921). On peut considérer que le communisme de guerre a rempli sa tâche principale : l'État a réussi à survivre, à préserver l'économie et à gagner la guerre civile.
À la fin de la Révolution d’Octobre, les bolcheviks commencèrent à mettre en œuvre leurs idées les plus audacieuses. La guerre civile et l'épuisement des ressources stratégiques ont contraint le nouveau gouvernement à prendre des mesures d'urgence visant à assurer sa pérennité. L’ensemble de ces mesures était appelé « communisme de guerre ».
À l'automne 1917, les bolcheviks prirent le pouvoir à Petrograd et détruisirent toutes les plus hautes instances dirigeantes de l'ancien gouvernement. Les bolcheviks étaient guidés par des idées peu cohérentes avec le mode de vie habituel en Russie.
- Causes du communisme de guerre
- Caractéristiques du communisme de guerre
- Politique du communisme de guerre
- Résultats du communisme de guerre
Causes du communisme de guerre
Quelles sont les conditions et les raisons de l’émergence du communisme militaire en Russie ? Puisque les bolcheviks ont compris qu'ils ne pouvaient pas vaincre ceux qui s'opposaient au régime soviétique, ils ont décidé de forcer toutes les régions sous leur contrôle à appliquer rapidement et clairement leurs décrets, à centraliser leur pouvoir dans le nouveau système et à tout enregistrer et sous contrôle. .

En septembre 1918, le Comité exécutif central déclare la loi martiale dans le pays. En raison de la situation économique difficile du pays, les autorités décidèrent d'introduire une nouvelle politique de communisme de guerre sous le commandement de Lénine. La nouvelle politique visait à soutenir et à reconfigurer l'économie de l'État.
La principale force de résistance qui a montré son mécontentement face aux actions des bolcheviks était les classes ouvrières et paysannes, c'est pourquoi le nouveau système économique a décidé de fournir à ces classes le droit de travailler, mais à la condition qu'elles soient strictement dépendantes du État.
Quelle est l’essence de la politique du communisme de guerre ? L'essentiel était de préparer le pays à un nouveau système communiste, vers lequel l'orientation a été prise par le nouveau gouvernement.
Caractéristiques du communisme de guerre
Le communisme de guerre, qui a prospéré en Russie dans les années 1917-1920, était une organisation de la société dans laquelle l'arrière était subordonné à l'armée.
Même avant que les bolcheviks n'arrivent au pouvoir, ils disaient que le système bancaire du pays et la grande propriété privée étaient vicieux et injustes. Après avoir pris le pouvoir, Lénine, pour pouvoir maintenir son pouvoir, réquisitionna tous les fonds des banques et des propriétaires privés.

Au niveau législatif politique du communisme de guerre en Russie a commencé son existence depuis décembre 1917.
Plusieurs décrets du Conseil des commissaires du peuple ont établi un monopole gouvernemental dans des domaines stratégiquement importants de la vie. Parmi les principales caractéristiques du communisme de guerre figurent :
- Le degré extrême de gestion centralisée de l'économie de l'État.
- Péréquation totale, dans laquelle tous les segments de la population disposaient de la même quantité de biens et d'avantages.
- Nationalisation de toute l'industrie.
- Interdiction du commerce privé.
- Monopolisation d'État des entreprises agricoles.
- Militarisation du travail et orientation vers l'industrie militaire.
Ainsi, la politique du communisme de guerre supposait, sur la base de ces principes, créer un nouveau modèle d’État dans lequel il n’y aurait ni riches ni pauvres. Tous les citoyens de ce nouvel État devraient être égaux et recevoir exactement le montant des prestations dont ils ont besoin pour mener une existence normale.
Vidéo sur le communisme de guerre en Russie :
Politique du communisme de guerre
L’objectif principal de la politique du communisme de guerre est de détruire complètement la relation marchandise-argent et l’entrepreneuriat. La plupart des réformes menées au cours de cette période visaient précisément à atteindre ces objectifs.
Tout d’abord, les bolcheviks sont devenus propriétaires de tous les biens royaux, y compris l’argent et les bijoux. Cela a été suivi par la liquidation des banques privées, de l'argent, de l'or, des bijoux, des grands dépôts privés et d'autres vestiges de la vie antérieure, qui ont également migré vers l'État. En outre, le nouveau gouvernement a établi une norme pour l'émission d'argent aux déposants, ne dépassant pas 500 roubles par mois.

Les mesures de la politique du communisme de guerre comprennent également la nationalisation de l'industrie du pays. Initialement, l'État a nationalisé les entreprises industrielles menacées de ruine afin de les sauver, car pendant la révolution un grand nombre de propriétaires d'industries et d'usines ont été contraints de fuir le pays. Mais au fil du temps, le nouveau gouvernement a commencé à nationaliser toutes les industries, même les plus petites.
La politique du communisme de guerre se caractérise par l’introduction du service universel du travail afin de stimuler l’économie. Selon ce texte, toute la population était obligée de travailler 8 heures par jour et l'oisiveté était punie au niveau législatif. Lorsque l’armée russe s’est retirée de la Première Guerre mondiale, plusieurs groupes de soldats ont été convertis en unités de travail.
En outre, le nouveau gouvernement a introduit ce qu'on appelle la dictature alimentaire, selon laquelle le processus de distribution des biens et du pain nécessaires à la population était contrôlé par les agences gouvernementales. À cette fin, l’État a établi des normes de consommation mentale.
Ainsi, la politique du communisme de guerre visait des transformations globales dans toutes les sphères de la vie du pays. Le nouveau gouvernement a rempli ses objectifs :
- Banques privées et dépôts liquidés.
- Industrie nationalisée.
- Introduit un monopole sur le commerce extérieur.
- Forcé au service du travail.
- Introduction d’une dictature alimentaire et d’un système d’appropriation des excédents.
Le slogan « Tout le pouvoir aux Soviétiques ! » correspond à la politique du communisme de guerre.
Vidéo sur la politique du communisme de guerre :
Résultats du communisme de guerre
Malgré le fait que les bolcheviks aient procédé à un certain nombre de réformes et de transformations, les résultats du communisme de guerre se résumaient à la politique habituelle de terreur, qui détruisait ceux qui s'opposaient aux bolcheviks. Le principal organisme chargé de la planification et des réformes économiques à l’époque – le Conseil économique national – n’a finalement pas réussi à résoudre ses problèmes économiques. La Russie était dans un chaos encore plus grand. L’économie, au lieu de se reconstruire, s’est effondrée encore plus rapidement.
Par la suite, une nouvelle politique est apparue dans le pays - la NEP, dont le but était de soulager les tensions sociales, de renforcer la base sociale du pouvoir soviétique par une alliance d'ouvriers et de paysans, d'empêcher une nouvelle aggravation de la dévastation, de surmonter la crise, de restaurer fermes et éliminer l’isolement international.
Que savez-vous du communisme de guerre ? Êtes-vous d’accord avec la politique de ce régime ? Partagez votre opinion dans les commentaires.